Chypre, un pays divisé depuis plus de cinquante ans
- Alp Turgut
- 13 déc. 2024
- 7 min de lecture
Dernière mise à jour : 6 oct. 2025
Télécharger le PDF ci-dessous :
Cette année nous observons la cinquantième année de séparation de l’île de Chypre en deux. Cette île de 9251km² est à la croisée des chemins, mais aussi des convoitises. La situation géographique et l’héritage historique de l’île méditerranéenne ont placé cette dernière dans un processus d’autodétermination à l’issue encore incertaine aujourd’hui. Indépendance, Enosis, Taksim, intégration à l’Union européenne et toujours cette « Ligne verte », véritable frontière terrestre pour une République insulaire. Il convient pour nous d’étudier, à partir de l’évolution de cette frontière et de ses aboutissants, les éléments formant la singularité de Chypre et de ses frontières.
Dans quelles mesures l’île chypriote est-elle le théâtre des affrontements de différentes représentations de la frontière ?
I - Une frontière par les Turcs, pour les Turcs ?
1. Une démarcation légitimée par l’ethnie

C’est avec l’arrivée de l’armée turque en 1974 sur l’île au nom de la protection de la minorité turcophone musulmane que l’île se scinde en deux. L’accord de cessez-le-feu de l’ONU et la création de la zone tampon vont donner forme à la frontière comme ligne de front. Les échanges de populations vont accentuer la séparation des communautés dans les deux parties respectives de l’île. Ainsi, depuis cette période, on fait perdurer une séparation physique entre deux communautés, les Chypriotes grecs et les Chypriotes turcs qui cohabitaient auparavant. Encore aujourd’hui la présence turque est très visible. En plus de la population autochtone, la Turquie incite des colons anatoliens à s’installer dans la partie Nord de l’île qu’elle contrôle. En 1983, la République turque de Chypre du Nord (RTCN) est autoproclamée. Celle-ci ne bénéficie de la reconnaissance d’aucun autre Etat que la Turquie et plonge la partie nord dans un isolationnisme. L’armée occupe toujours 37% de l’île et aucun passage de l’autre côté de la frontière n’est possible. C’est au nord de Nicosie que la démonstration symbolique de la présence politique est la plus évidente. Deux drapeaux, d’une superficie égale à celle de stades de football dominent la ville et rappellent aux chypriotes grecs la présence du pouvoir politique de la communauté turcophone. L’un est visible le jour, l’autre s’éclaire la nuit, ainsi personne ne peut les ignorer car ils sont visibles de très loin 24 heures sur 24 et bien orientés vers le sud.
2. La domination d’un (grand) frère sur l’autre
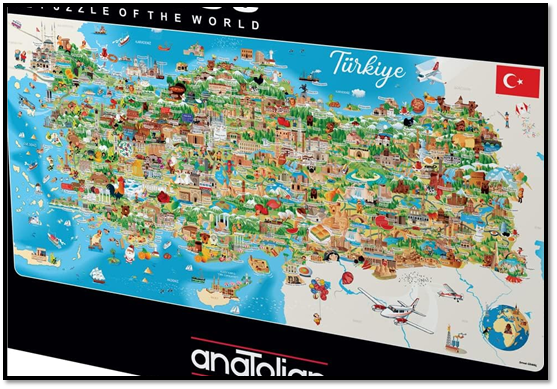
La domination de la Turquie sur la RTCN n’est pas qu’économique ou politique. La représentation de la ligne Attila est le point central de la reconnaissance de la scission Nord Sud de l’île que met en avant la Turquie pour servir ses propres intérêts. Dans ce cadre-là, la Turquie s’inscrit dans une stratégie similaire à celle de la Russie avec les territoires ukrainiens. Des représentations cartographiques de la Turquie incluent dans son propre territoire la RTCN, ce qui lui permet de faire exister une frontière qui n’est pas visible ou contestée par l’Union européenne (UE) et la République de Chypre.
II - Le chemin (difficile) du « debordering »
1. La présence onusienne – moteur ou frein de la réouverture ?
Depuis l’invasion de 1974, la force de maintien de la paix de l’ONU (UNFICYP) forme une zone tampon entre l’occupant du Nord et le Sud. Philippe Achilléas revient sur la formation de la ligne verte représentée par la présence onusienne. Cette ligne discontinue serpente entre villages chypriotes grecs et chypriotes turcs. L’enclave de Kokkina/Erenköy à titre d’exemple est un héritage de ces combats de 1964 à 1974 entre Chypriotes grecs et Chypriotes turcs. Elle est inaccessible pour les civils du Sud il est nécessaire de la contourner ce qui rallonge les temps de trajets dans cette région. Ainsi, les trajets entre Pomos et Kato Pyrgos ou Dali et Atheniou (villages en République de Chypre) se voient rallongés par des détours dus à la zone tampon de l’UNFICYP s’étendant sur 3% de l’île.

Cette présence est parfois remise en question tant par la RTCN qui s’appuie sur la nécessité de consentement que nécessite cette mission de maintien de la paix de l’ONU selon le chapitre VI de la Charte, qui nécessite aujourd’hui dans les faits celui de l’unique Etat reconnu de l’île, la République de Chypre.
Aussi, les manifestations devant le Ledra palace, QG de l’UNFICYP, avant et dès l’ouverture de la frontière le 23 avril 2003, sont le symbole d’une contestation contre cette présence qui est vue de certains comme un frein à l’ouverture, marquant la matérialité de la frontière.
Cette frontière qui était jusque-là un no man’s land pour les civils des deux parts de l’île, voit depuis 2003 un premier élan de debordering.
2. L’élargissement de l’UE – première ouverture de la frontière
Si l’ouverture de la frontière par la RTCN avait pour objectif de mettre en avant son aspect protecteur pour les populations turcophones du Nord, l’intégration de Chypre à l’ONU accentue les aspirations d’ouverture et de libre circulation. Le debordering est confirmé par les ouvertures progressives de nouveaux points de passage et checkpoints à l’instar de celui non loin de Lefka où l’on voit des célébrations et réjouissance de cette ouverture.


Cette ouverture était auparavant inimaginable car la RTCN avait pour stratégie de marquer sa souveraineté par l’immobilisme et l’imperméabilité de sa frontière tandis que la République de Chypre interdisait son passage à sa population afin de ne pas légitimer le contrôle douanier opéré au niveau de la ligne verte. Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères français informe les ressortissants français de la particularité de l’île où malgré son intégration totale à l’UE de jure, la juridiction de cette dernière s’étend de facto sur le territoire de la République de Chypre uniquement. Malgré la non-reconnaissance internationale qui interdit aux douaniers de la RTCN de tamponner les passeports des civils traversant la frontière, une pièce d’identité est obligatoire pour la passer, comme le montre le JT de TF1.
3. Une nouvelle route migratoire mettant en lumière les rapports à la frontière
La proximité de Chypre à la côte méditerranéenne la rend, depuis son intégration à l’UE, un nouvel objectif pour les migrants. Certains tentent de traverser la mer depuis le Liban ou la Syrie, d’autres prennent l’avion depuis Istanbul pour se rendre directement sur l’île dans la partie Nord guère vigilante à ce sujet de l’immigration. La République de Chypre n’est également pas très regardante sur la question migratoire car la mise en place de contrôles à la frontière signifierait qu’elle reconnaîtrait son existence. Ainsi, la Ligne verte, à la différence des autres frontières extérieures, n’est pas une frontière anti-migration mais une frontière étatique pour la RTCN et « rien du tout » pour la République de Chypre qui reconnaît comme unique frontière la mer (outre les bases militaires britanniques). De nombreux camps de réfugiés comme celui de Pournara accueillent les migrants demandeurs d’asile.
III – La mise en tourisme de la frontière
1. Une frontière figée dans le temps

Dans leur article, Lageiste et Moullé mettent en avant les débris et barricades des frontières construites par les Chypriotes. Dans le JT de TF1 ou la photographie ci-contre, de nombreuses ruelles de Nicosie se terminent en impasse en raison des résidus des combats et oppositions dont la capitale de l’île conserve les traces, comme pour commémorer les dissensions ayant coulé tant de sang.
2. Un tourisme enracinant la frontière

Dans la même idée que Lageiste et Moullé, ces restes de frontières sont source de tourisme note Marie Pouillès Garonzi. Il est mention ici d’une frontière comme attrait touristique selon Pierric Calenge qui attire un tourisme bien particulier : tourisme d’urbex ou thanatourisme. Il est fréquent de se voir proposer des attractions touristiques autour du franchissement de la zone tampon ou d’approcher la ville fantôme de Varosha/Maras par la mer sur un petit bateau de croisière.
IV – La lutte des imaginaires de la frontière
1. Une frontière de mémoire
Deux mémoires s’affrontent dans cette frontière de la Ligne verte. Si certaines représentations de partis nationalistes revendiquent le devoir de mémoire d’un peuple victime de persécutions, le village de Pyla, unique village intercommunautaire de l’île, situé dans la zone tampon même est un symbole d’espoir pour ces deux peuples qui auparavant cohabitaient. Chloé Emmanouilidis met en avant dans son article le caractère certes singulier mais admirable de ce village
2. Berlin épisode n°2 ?

Nicosie est la dernière capitale d’Europe encore coupée en deux par un mur, ici la zone tampon de l’ONU formant la Ligne verte. Les références au mur de Berlin et un destin similaire marquent de nombreux esprits des locaux et associations comme Unite Cyprus now. Les tags, œuvres d’art, événements et même nom de restaurant vont dans ce sens d’une future réunion en construction.
Conclusion
La frontière de Chypre est une frontière tantôt souveraine d’un Etat selon une représentation turque, marquée d’intérêts économiques, stratégiques et culturels, tantôt un statut juridique nul, à ignorer, mais symbole d’une mémoire à commémorer. Le debordering progressif de la frontière, dont l’évolution est visible par sa matérialité n’est pas sans paradoxes et difficultés. Le tourisme et la reconnaissance inévitable d’un statut de frontière ont tendance à normaliser celle-ci et certains projets politiques à s’appuyer dessus. La réouverture progressive après la pandémie du Covid des points de passage fermés de 2021 à 2023 est le signe d’une frontière qui conserve encore aujourd’hui une marche vers une ouverture totale et pérenne encore lointaine mais non inatteignable.
Bibliographie et annexes
Disponibles au sein du fichier PDF ci-dessus.



Commentaires